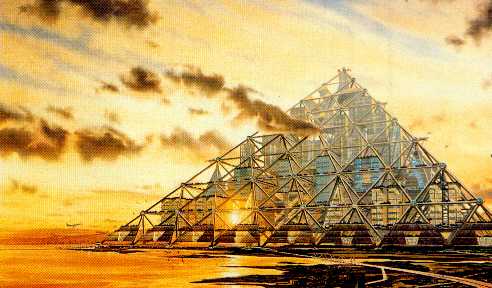William Le Baron Jenney est le premier à retrousser ses manches et à crayonner ses planches. En 1884, cet ingénieur architecte ose la hauteur. Il signe le premier véritable gratte-ciel : le Home Insurance Building, un immeuble de 10 étages ossature métallique. Une grande première, ni pierre, ni bois, le squelette de l'édifice est en acier, un tout nouveau matériau sorti tout droit des laminoirs américains : il est à la fois léger et résistant. C'est un alliage fait de fer et de carbone qui permet de nouvelles audaces architecturales. Pour monter plus haut, il suffit d'augmenter légèrement la largeur de la base de l'édifice. Un peu comme si on empilait des cubes. Le rapport limite étant, à l'époque, de 1 m de large pour 5 m de haut (aujourd'hui, il est de 1 pour 10 grâce au progrès technique). William Le Baron Jenney est le premier à retrousser ses manches et à crayonner ses planches. En 1884, cet ingénieur architecte ose la hauteur. Il signe le premier véritable gratte-ciel : le Home Insurance Building, un immeuble de 10 étages ossature métallique. Une grande première, ni pierre, ni bois, le squelette de l'édifice est en acier, un tout nouveau matériau sorti tout droit des laminoirs américains : il est à la fois léger et résistant. C'est un alliage fait de fer et de carbone qui permet de nouvelles audaces architecturales. Pour monter plus haut, il suffit d'augmenter légèrement la largeur de la base de l'édifice. Un peu comme si on empilait des cubes. Le rapport limite étant, à l'époque, de 1 m de large pour 5 m de haut (aujourd'hui, il est de 1 pour 10 grâce au progrès technique).
 La course à la hauteur est lancée. Les architectes ont soif d'altitude, les promoteurs sont gonflés de dollars. Banques, compagnies d'assurances, grands journaux, grands magasins, tous cherchent à épater la galerie en installant leurs bureaux dans des immeubles flambant neuf et surtout le plus élevé possible. Dans cette compétition, deux villes tiennent le haut du pavé : New York et Chicago. Les deux villes vont se livrer un combat sans merci car la hauteur des immeubles d'une ville représente la puissance, le pouvoir, et surtout prouve qu'ils ont beaucoup d'argent. En 1888, c'est New York qui passe en tête. Leroy Buffington dessine une tour de bureaux de 28 étages. A l'époque, en baptisant son œuvre "gratte nuage", Buffington passe pour un fou ! Trois ans plus tard, le Daily News de Boston consacre à jamais le sobriquet "gratte ciel" pour désigner ces mastodontes. Quatre ans plus tard, le Masonic Temple de Chicago reprend le flambeau. En 1892, les architectes Burham et Root hissent cet édifice sur la plus haute marche du podium. Le lauréat, dont la coiffe frise les 100 m de haut, sera le premier immeuble consacré "le plus haut du monde". L'imposant américain est pourtant loin de faire de l'ombre à notre Tour Eiffel nationale. Notre Belle, qui affiche alors trois ans au compteur, roule des mécaniques avec ses 312 m sous la toise. Mais la grande parisienne reste une simple tour de ferraille aux yeux des architectes. Hélas pour Chicago, après la construction du Masonic Temple, le conseil municipal prend peur, il était temps ! Est-ce bien raisonnable d'aller toujours plus haut et si vite ? En 1893, le maire en a par-dessus la tête et décide de calmer le jeu. Il plafonne la hauteur des immeubles de sa ville à une quarantaine de mètres... A New York, aucune loi ne vient ni limiter la masse ni la taille des buildings. Les gratte-ciel y poussent comme des asperges. Les rues se transforment en canyons de béton et de verre. Ainsi, en 1909, à Manhattan, le Singer Building pousse le chant de la victoire : 187 m de haut, soit 50 m de plus que la grande pyramide de Khéops. La même année, la Metropolitan Life Tower émerge à 214 m. En 1913, le Woolworth Building joue les vedettes sur Broadway en imposant ses 241,50 m. Ce gratte-ciel superbe, dont les ornements rappellent ceux d'une église gothique, sera surnommé "cathédrale du commerce". La course à la hauteur est lancée. Les architectes ont soif d'altitude, les promoteurs sont gonflés de dollars. Banques, compagnies d'assurances, grands journaux, grands magasins, tous cherchent à épater la galerie en installant leurs bureaux dans des immeubles flambant neuf et surtout le plus élevé possible. Dans cette compétition, deux villes tiennent le haut du pavé : New York et Chicago. Les deux villes vont se livrer un combat sans merci car la hauteur des immeubles d'une ville représente la puissance, le pouvoir, et surtout prouve qu'ils ont beaucoup d'argent. En 1888, c'est New York qui passe en tête. Leroy Buffington dessine une tour de bureaux de 28 étages. A l'époque, en baptisant son œuvre "gratte nuage", Buffington passe pour un fou ! Trois ans plus tard, le Daily News de Boston consacre à jamais le sobriquet "gratte ciel" pour désigner ces mastodontes. Quatre ans plus tard, le Masonic Temple de Chicago reprend le flambeau. En 1892, les architectes Burham et Root hissent cet édifice sur la plus haute marche du podium. Le lauréat, dont la coiffe frise les 100 m de haut, sera le premier immeuble consacré "le plus haut du monde". L'imposant américain est pourtant loin de faire de l'ombre à notre Tour Eiffel nationale. Notre Belle, qui affiche alors trois ans au compteur, roule des mécaniques avec ses 312 m sous la toise. Mais la grande parisienne reste une simple tour de ferraille aux yeux des architectes. Hélas pour Chicago, après la construction du Masonic Temple, le conseil municipal prend peur, il était temps ! Est-ce bien raisonnable d'aller toujours plus haut et si vite ? En 1893, le maire en a par-dessus la tête et décide de calmer le jeu. Il plafonne la hauteur des immeubles de sa ville à une quarantaine de mètres... A New York, aucune loi ne vient ni limiter la masse ni la taille des buildings. Les gratte-ciel y poussent comme des asperges. Les rues se transforment en canyons de béton et de verre. Ainsi, en 1909, à Manhattan, le Singer Building pousse le chant de la victoire : 187 m de haut, soit 50 m de plus que la grande pyramide de Khéops. La même année, la Metropolitan Life Tower émerge à 214 m. En 1913, le Woolworth Building joue les vedettes sur Broadway en imposant ses 241,50 m. Ce gratte-ciel superbe, dont les ornements rappellent ceux d'une église gothique, sera surnommé "cathédrale du commerce".
|